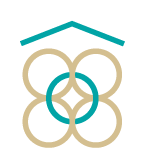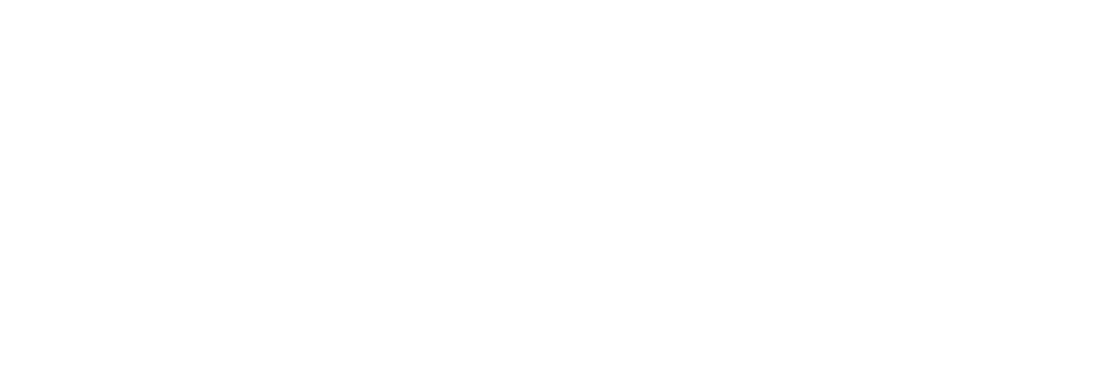Des organismes d’aide pour femmes constatent une baisse d’achalandage dans leurs ressources depuis le début de la pandémie. Une situation qu’elles jugent alarmante, car elles ne savent tout simplement plus où elles sont ni pourquoi elles demandent moins de services, alors que la situation de celles qu’elles voient est plus précaire que jamais.
« On ne sait pas où sont les femmes, et ça nous inquiète beaucoup », dit Geneviève Hétu, directrice générale de la Maison Passages, qui offre de l’hébergement de courte durée aux jeunes femmes qui vivent des situations difficiles.
Contrairement à plusieurs organismes, la Maison Passages n’a ni fermé ses portes ni diminué son nombre de places disponibles depuis le début de la pandémie. Mais contre toute attente, plusieurs des lits restent vides nuit après nuit.
Le taux d’occupation de la ressource, qui est généralement de plus de 80 %, a baissé à 63 % cette année. Et certains mois, la moitié des lits sont vides.
Celles qui viennent peuvent toutefois rester plus longtemps. « On ne va pas les mettre dehors après trois jours si elles n’ont pas de place où aller, alors que notre maison est vide », affirme Mme Hétu.
Le nombre d’appels — pour avoir une place, pour trouver des lits dans d’autres organismes ou simplement pour donner des nouvelles — a également chuté de façon importante. Au mois de janvier, l’organisme a reçu 39 appels, contre 90 en temps normal.
Que se passe-t-il ? Où sont les femmes ? C’est la question que Geneviève Hétu et ses collègues d’autres organismes se posent, car ils sont tous confrontés au même phénomène, mais à différents niveaux.
À l’auberge Madeleine, on constate également une baisse de l’achalandage. Ici, la maison roule à plein régime en tout temps, mais on refuse moitié moins de gens qu’à l’habitude. « L’an dernier, on a refusé 6300 demandes. Ça veut dire qu’à 6300 reprises, on a dû dire à une dame qu’on ne pouvait pas l’héberger parce qu’on n’avait pas de place pour elle, explique Mélanie Walsh, directrice de cette ressource pour femmes. Cette année, entre le 1er avril 2020 et le 31 janvier 2021, j’en suis à 2832 refus. Donc oui, la demande a diminué, mais ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle, car ça veut dire que les femmes se terrent. »
Même son de cloche à La Rue des femmes, qui, contrairement à son habitude, n’affiche pas toujours complet. « Le mouvement est totalement imprévisible, et il arrive que, des journées, la demande soit moins grande », confie la directrice, Nicole Pelletier.
Hypothèses
Mélanie Walsh se dit particulièrement inquiète, car plusieurs études ont démontré que les femmes sont davantage affectées par la pandémie. « Une de nos hypothèses, c’est que, si elles ont un toit au-dessus de leur tête, elles vont y rester, si insupportable, si insalubre soit ce lieu ou si violent soit le partenaire qui les accueille. »
Nicole Pelletier abonde dans ce sens : « Au début du couvre-feu, les femmes avaient très peur de se ramasser dans la rue après 20 h, alors peut-être qu’elles trouvent des solutions temporaires qui ne sont pas idéales pour elles. »
Le mouvement des femmes itinérantes fluctue beaucoup en fonction des besoins immédiats. Ainsi, plusieurs ont quitté le centre-ville lorsque celui-ci était désert au début de la pandémie, car elles ne pouvaient plus y quêter. D’autres ont opté pour le campement Notre-Dame pendant l’été ou essaient les nouvelles ressources d’hébergement d’urgence au fur et à mesure que celles-ci ouvrent.
Certaines femmes vont également offrir des faveurs sexuelles en échange d’un hébergement temporaire, rappelle Mélanie Walsh. « C’est d’autant plus inquiétant que les femmes vivent une itinérance cachée, elles vont s’invisibiliser elles-mêmes pour éviter d’être étiquetées comme itinérantes. Elles fréquentent moins les lieux mixtes et les refuges d’urgence dans les arénas qui répondent moins à leurs besoins. »
Autre hypothèse avancée par Geneviève Hétu de la Maison Passages : les femmes qui avaient avant la pandémie un emploi instable et très précaire ont bénéficié de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), ce qui leur a permis de se payer une chambre dans un petit hôtel. « Plusieurs femmes m’ont répondu qu’elles étaient à l’hôtel, ce qu’elles se permettent généralement quand elles reçoivent leur chèque au début du mois. »
Et la crise du logement vient compliquer les choses de celles qui tentent de s’en sortir : « C’est sûr qu’en ce moment, ça devient très compliqué pour une femme en difficulté de se trouver un logement qui soit sécuritaire, abordable et salubre », résume Mélanie Walsh.
Les trois directrices contactées par Le Devoir constatent que les femmes qui continuent de fréquenter leurs services sont dans une situation plus précaire que jamais. « Je ne sais pas si c’est notre regard, mais il me semble que les femmes arrivent plus “poquées”, avance Mme Hétu. Étrangement, on a été chanceux que notre maison se vide parce que les cas sont lourds. »
Stress, anxiété, problèmes de santé mentale et de consommation, tout semble avoir explosé avec la pandémie. « Leur état de santé a empiré. Celles qui consommaient consomment plus, celles qui étaient désorganisées le sont encore plus, oui, la situation s’est détériorée », confirme Nicole Pelletier.
Les jeunes aussi
Il n’y a pas que les femmes qui soient plus difficiles à trouver. Plusieurs organismes qui travaillent avec les jeunes de la rue vivent la même situation, a pu constater Le Devoir. « On a quelques jeunes qui sont allés au campement Notre-Dame ou dans d’autres refuges d’urgence, certains vont à l’hôtel Dupuis, mais les autres, on ne sait pas où ils sont. Ils sont quelque part, précaires, mais où exactement ? On ne le sait pas ! » dit France Labelle, directrice générale du Refuge des jeunes.
« Au cours d’un mois, on peut voir entre 100 et 125 jeunes différents, là on en voit une cinquantaine. Ils sont où, les autres ? On ne le sait pas ! C’est peut-être positif, s’ils ont trouvé un endroit plus stable, mais on ne le sait pas encore. Ce sera à mettre en perspective de l’autre côté de la pandémie. »
À la Clinique des jeunes de la rue, du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, on constate aussi une diminution de la fréquentation des jeunes dans toutes les ressources partenaires comme les refuges et les centres de jour depuis le début de la pandémie. « On essaie de s’expliquer ça. C’est sûr que les jeunes ont vraiment perdu leurs repères avec la pandémie », indique Mari-Lou Dumont, coordonnatrice clinique.
Selon elle, ceux qui avaient encore des ressources — des parents, des amis — se sont tournés vers eux, mais les plus démunis, ceux qui n’avaient plus aucun filet de sécurité, sont ceux que l’on voit aujourd’hui dans la rue.
Ici aussi, on constate que les cas sont plus lourds : davantage de symptômes anxieux et dépressifs, plus de prescriptions, plus de demandes formelles pour des suivis psychosociaux. « On a beaucoup de demandes pour ces services parce qu’il y a plus de détresse », résume Mme Dumont.